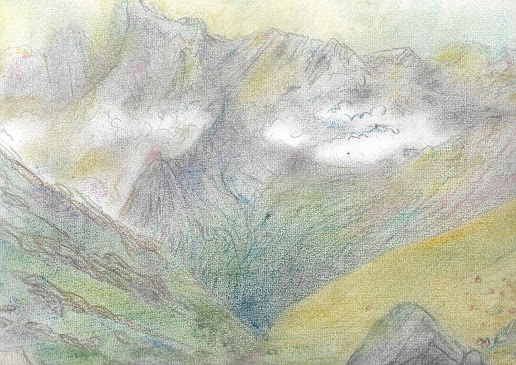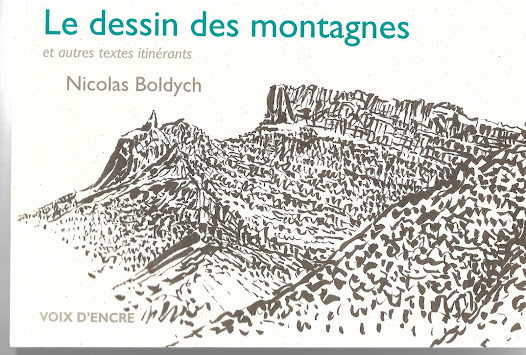Sur le vent
Eté 2019
0 Le vent....
1
Le vent vient après, à la fin,
comme une nécessité à laquelle on n’avait pas pensé au début, au temps de la
création, de la mise en place des êtres et des choses sur la carte du monde.
C’est le plus naturel, le plus neutre, le plus impassible aussi des justiciers
de l’espace et de l’air.
Personne n’accomplit sa mission -
rétablir l’équilibre des pressions dans toute la rose-, avec tel mélange de
laisser-aller informe et de violence que lui.
A la fin, ou au recommencement
d’un cycle, le sacré équilibre des pressions, par le vent, est source de grande violence...
2
Ces derniers jours le vent a
soufflé avec une régularité assommante, qui n’avait rien à dire et qui pourtant
accaparait notre attention. A quoi
aspire le long bras du vent ? sinon à nous rappeler, à nous souffler à
l’oreille combien l’horizon est profond, infiniment profond pour nous, combien
l’espace (que nous réduisons trop souvent aux vitesses que nous mettons à le
traverser) est réel avec ses masses d’air mal équilibrées qui font que
pressions et dépressions alternent violemment, comme dans les moteurs à
explosion des consciences.
(Le lointain, c’est le lointain
qui nous parle à l’oreille à travers lui.)
Le vent-messager de l’espace, des
espaces qui s’entre-chevauchent s’ignorant, le vent qui fait le lien, volontiers
explosif, entre ces espaces -mesurant les béances ignorées, mesurant à la faire
frémir notre ignorance de l’Espace dans ce qu’il est de plus global,
d’incommensurable et de noble-, le vent qui gonfle les espaces déprimés, avec sa
pompe et ses gorgones invisibles, ses hydres en haillons, ses cris feulées et
sans grammaire...
… a beaucoup soufflé ces derniers
temps, au col où j’ai longtemps hésité à dresser ma tente qui aurait pu
soudainement , comme un delta-plane, « faire voile » en prenant le large dans le ciel bleu qui décille, à l’occasion d’une trop appuyée
rafale susurrée depuis un col alpin, pendant la longue nuit astrale qui nous
traverse autant qu’on la traverse.
Le vent en a la force, il a la force pour lui,
lui qui ne connaît pas sa force, lui qui n’est qu’une force appliquée depuis
les profondeurs, intraçables, indicibles, tabou en fait, de l’Espace...
L’espace s’est donc beaucoup
plaint ces derniers temps, a beaucoup gémi dans nos oreilles trop petites, trop
mesquines pour la puissance de son messager, le vent. L’espace au grand
souffle, l’espace des grandes égalisations finales, l’espace des vides
communicants, avait son mot à dire qui, en apparence, était pur persiflage par cols et vallées…
Ai entendu le vent se gargariser
d’abord d’une absence de larynx, pharynx, de trachée, puis faire mine de
parler, ouvrant grand sa gueule vide dans la nuit astrale.
Je l’ai entendu clairement, saisi
clairement, ces derniers jours, en particulier lorsque je montais au- dessus
des mille mètres pour chercher un état plus primitif de la lumière avant la
nuit.
Il était appliqué, il était
concentré, il sifflait du plus profond de l’espace à l’immensité re-suscitée ; avec une magnifique
régularité à laquelle on ne pouvait qu’avoir envie d’échapper, que tout esprit
sain ne pouvait qu’avoir envie de fuir au plus vite, et qui pourtant venait du
plus profond de l’espace, de ce noble espace inutile des fonds de vallée et des
nuages trop hauts dans le ciel que l’on ignore trop souvent, dont on n’ignore
trop souvent la réalité qui ne se dit pas, qui ne parle pas, hormis par le
vent...
J’ai donc écouté, pris dans les
filets de son souffle, de son chant sans syllabes, prêt à entendre enfin quelque chose, à
faire mine de le comprendre, de l’accueillir. J’envoyais mon ambassade, l'ouïe, dans les
hautes sphères pour recueillir sa profonde doléance et attendais.
Or, au bout de quelques minutes,
je me suis surtout, seul sous ma tente, dit que le vent était aphone, ou
muet... et que là était son, ou notre, principal problème car si, ou moins dans
ces longues, de plus en plus longues en apparence, périodes où il souffle
encore et encore sur nos vies trop enracinées, il pouvait dire quelque chose, s'il pouvait lâcher le morceau et se réaliser... Mais non. Cet air ne sert à aucun son, aucune
parole, il est une perte qui siffle dans nos oreilles fêlées...
J’entends ce long sifflement de colère sans
objet qui toujours s’étire, qui avance en reculant s’épuisant dans l’espace et le temps, sans jamais
former de phonème, même pas les spirantes, les « ssss », ou un « ffff »...
Qui mesure seulement les
incommensurable béances de l’espace.
Laisser-aller du vent donc,
incapacité du vent à s’auto- saisir et cracher le morceau.
A se dire.
3
Il n’y a rien de plus
violent que le vent, rien de plus violent, en fait, que ce qui manque de forme,
qui manque sa forme incessamment et revient toujours à son chaos originel,
comme le vent... rien de plus violent que ce qui est condamné pour toujours à
sans cesse se fuir et se chercher.
Et ainsi me semble le vent,
pauvres en attributs, mal défini, s’étirant démesurément entre son début et sa
fin qui ne vient pas ...
Mal définissable par l’oreille
qui l’entend et les yeux qui ne le voient hormis négativement, c’est cela
« négativement ». Le vent a une existence négative, occupe des
territoires vides, vidées, s’en donne à cœur joie dans les marges ignorées,
perdues, les stratosphères...
Il brosse les arbres, caresse les
rochers, défrise les barbes. Mal formé, mal défini, mal compris,
incompréhensible plutôt, est le vent... oui mais...
4
...mais lorsqu’il se reprend,
lorsqu’il se saisit follement par le collet et rassemble à la va-vite la cohue
des milles diables, quand il raccorde ses haillons stratosphériques...
Fou...Fichtre, persiffle alors et
se faufile où veut, s’éparpille échevelé les
mains pleines de haillons à la langue de serpent... vent perdure, presse
et compresse,
déracine tout ce qui se perd au milieu de l’espace, tout ce qui
veut exister idiotement à en oublier l’espace et ses lois atmosphériques, et sa
justice stratosphérique qui vient à la fin...
...lorsqu’il réalise, après un
long moment lugubre d’errement sans nom, sans langue, après une longue période
d’hululements de ses lubies désincarnés, lorsqu’il parvient à l’union de ces
cohues mal élevées, de ses forces anciennement désorientées, le vent siffle alors sa puissance inaudible,
sa puissance proprement bientôt assourdissante et le son, la balle même, qu’il est tout entier
alors transperce tout, avant même que le poing du vent, qui vient en fait
seulement après le son, n’abatte ce qui a déjà été percé.
La perte est dramatique, cataclysmique même
pour nous qui sommes soudain perdus au milieu de l’espace, les yeux grand ouverts vers un extérieur que nous ne comprenons plus.
Il se vide de lui-même, mais dans
ce vacarme, ce que l’on entend peut-être encore le mieux, c’est que le vent
malgré cela, malgré qu’il ait toute latitude pour s’exprimer, c’est que le vent
ne parle toujours, jamais, - pas même ne gueule, ne parlera jamais, toujours
restera au seuil enchanté du langage, malgré d’extraordinaires possibilités,
4
toujours restera aphone...
Quel silence alors ! quel
sale silence alors, malgré tout... Quel silence froissé !
Il restera à siffler sans gorge,
sans lèvre, à nos oreilles impuissantes à le comprendre, impuissantes à filtrer
cette bouillie sonore qui cascade en toute monotonie hivernale ou automnale
dans le tympan.
Se vide tout simplement, vide...
5
J’entends, sur les crêtes le vent
se retirer lestement, tout en souplesse – il est aspiré par un vide, plus
puissant que lui, un vide cosmique, stratosphérique dans lequel il se dissout
comme un souvenir sans corps, comme un pauvre sel sans lendemain , mais
pour mieux revenir ensuite avec sa faux à nouveau aiguisée, ; pendant des
heures, alors que j’étais calfeutré dans
mon duvet sous ma tente, le son m’a accompagné, faiblissant parfois, dans des
minutes d’oubli, épuisant tout à la fin sauf lui-même, cherchant sa fin
qui ne venait pas...
Quand il faiblit ce bruit d’air
froissé qui persiste au centre vide de l’oreille, qui est alors à la seule à se
souvenir de lui, de sa manifestation...
Notre visage, notre corps est-il
donc une voile pour être ainsi suscité par le vent, embrassé-giflé par lui, par le
messager... est-il susceptible d’être emporté par le vent... ?
Non il n’a rien à tirer
de nous, aucun geste spontané comme ceux de ces arbres, en bord de lac, qui se
tordent, qui ploient avec des grimaces de courtisanes sous ses rafales sans
queue ni tête....
6
Nous ne sommes pas un instrument
pour le vent, pas une voile pour lui, ou claire girouette. Il ne fait que froisser notre patience,
agacer notre cœur, nous fait entendre ce qui ne laissera pas de trace, le sans
traces, le sans articulations, le pur bruit abrasif du présent, ainsi que, parfois,
le silence froissé du cosmos infini dont il
est le messager sans message, hormis lui-même.